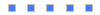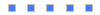Cinéma de rue 
Image noire et fixe, attente, longue attente, soudain surgit sous la lumières blafarde des projecteurs un jeune homme, air hagard et allure négligée, qui nous interpelle. Nous, spectateurs, masses sombres indistinctes s'entassant dans les salles obscures. 'Que faites vous dans ce lieu? Traîner ici ne fera rien bouger, la toile est désespérément vide. La différence entre vous et moi ? vous n'avez pas le droit de fumer (il allume une cigarette). Vous n'avez pas à être si tendu, voyons… essayez de vous détendre un peu, mettez votre main sur la fille près de vous. Continuez, touchez son genou…si ça ne marche pas, pas grave !, dites vous que personne ne sais qui vous êtes'. D'emblée Terayama nous prévient de ses obsessions. Artiste polymorphe, homme de littérature, homme de théâtre, il pose un regard détaché sur le médium cinématographique contestant son utilité même. Le jeune homme à l'écran, le double du cinéaste (avec qui il partage le même patois). Abandonné par sa mère à l'age de treize ans, Terayama trouve refuge, vit et dort littéralement derrière la toile du cinéma que tient son oncle dans la région de Tohoku au nord du Japon . Passé de l'autre coté du miroir, sa perception du cinéma s'en trouve profondément bouleversée. Ombres et lumières des acteurs, masses aveugles des spectateurs inconnus lui dévoile la supercherie propre au septième art, images factices et impalpables, supports d'une conscience et mémoire collective.
L'acteur à l'écran s'appelle Sasaki Hideaki, son personnage Kitamura Eimi , l'histoire qu'il nous raconte, c'est le film qui va se dérouler pendant deux heures, pas de fiction c'est son drame intime qui se dévoile, fait de doutes et de galères au sein d'une cellule familiale en pleine spirale auto-destructrice dans le pauvre Shinjuku de la fin des années 60. Sasaki Hideaki, cela aurait pu être beaucoup d'autres destins encore. En effet, 'Jetons les livres… est un vaste projet typique de la démarche artistique de Terayama ; avant d'être un film, ce fut une pièce de théâtre itinérante où sa troupe d'avant-garde, le Tenjo Sajiki (littéralement 'le Paradis' ), invitait sur scène les poètes adolescents locaux à exprimer leur rancœur, leur espoirs dans une pièce sans scénario pré-écrit, variant selon l'humeur du moment et la réaction du public qui faisait partie intégrante de la distribution. En remontant la genèse de l'œuvre, Jetons les livres… était à l'origine une de ses nouvelles intitulée Iede no susume (Incitations à la fugue) où se dessinaient déjà les doutes d'une jeunesse en manque cruel d'émancipation, de libération et d'expression. En prélude à la sortie du film en avril 71, Terayama sortit un recueil multimédia en étroite collaboration avec l'artiste Tadanori Yoko. Assemblage de poèmes, de photographies de sensations, d'impressions, cette sensibilité fragmentaire mêlée aux performances scéniques, autant de courants qui se croisent, se renforcent pour insuffler cette tonalité et esthétique si particulière, si précieuse à ce long-métrage.
De par son titre, Jetons les livres… s'inscrit directement dans la riche lignée des films subversifs et contestataires des années soixante où l'actualité brûlante trouve des résonances profondes dans les œuvres produites par, entre autres, Nagisa Oshima (Journal d'un voleur de Shinjuku, Contes cruels de la jeunesse, l'enterrement du soleil, la Cérémonie), Masahiro Shinoda (Youth in Fury, My Face Red in the Sunset, Epitaph to My Love, Tears on the Lion's Mane…tous scénarisés par Terayama) Koji Wakamatsu (Violated Angels, Go go second time virgin), Toshio Matsumoto (l'œdipien Funeral Parade of Roses), Masao Adachi (Sain, 15 ans..prosituée, l'Armée rouge japonaise). Renouvellement du traité de sécurité nippo-américain, guerre du Vietnam, bouillonnement culturel et artistique, révolte étudiante, drogues et psychédélisme, perte de l'identité nationale face à l'hégémonie américaine
Même si la filiation est évidente et les références abondantes, Terayama est une tête de file de l'avant-garde japonaise, le film s'attache avant tout au portrait introspectif d'un jeune paumé, un ronin (personne ayant échoué à l'examen d'entrée à l'université) comme il se décrit lui même Survivant dans un Shinjuku délabré, bien loin de ce qu'il est devenu de nos jours, en compagnie de son envahissante famille Un père alcoolique et chômeur, voyeur à ses heures perdues et n'arrêtant pas de lui quémander de l'argent , une mère disparue (la figure maternelle occupe une place prépondérante et obsessive dans l'œuvre de Terayama, résurgence d'une enfance tragique), une grand-mère kleptomane volant à l'étalage, affabulatrice qui en pleine déprime propose, à qui l'aimera, de partager les gains de son (fictif) billet gagnant de loterie. Autant de figures garantes de l'autorité mais aussi de l'éducation et de la morale, hommes et femmes démissionnaires métaphore d'un Japon défaitiste jamais tout à fait remis du traumatisme et des bouleversements de la seconde guerre mondaile. A ses cotés, Setsuko, une sœur quasi-autiste qui jure une haine féroce envers les hommes et se réfugie dans le réconfort d'une amitié imaginaire avec son lapin, animal plus tard assassiné par la grand-mère délaissée.
Assez différent de la veine fantasmatique et utopique de la révolution sexuelle de son précédent Empereur Tomato Ketchup tourné à la même époque, le film se prostre dans un pose passiviste et introspective pour mieux se libérer par la suite. Plus qu'un ressassement de la déprime, Terayama y plonge pour mieux trouver l'énergie de rebondir. Jetons les livres c'est surtout le destin de Kitamura Eimei qui de jeune homme introverti hantée par la présence possessive d'une mère qu'il hait va progressivement se muer en homme volontaire et extraverti. Une transformation radicale qui trouve son origine dans son dépucelage avec une prostituée nommé Setsuko. Evidente figure métaphorique de l'inceste, Terayama se plonge avec délice dans l'exploration freudienne de ses personnages, une thématique, qui le temps avançant, se fait de plus en plus présente dans son oeuvre. Introspection, exorcisation des souvenirs et traumas, libération, extériorisation et agitation, voici l'essence même de l'œuvre
La structure narrative est donc le reflet de sa thématique mais aussi de sa genèse polymorphe. Récit déstructuré où les errements de Kitamura, pendants littéraires du projet, constituent la colonne vertébrale d'un récit auquel viendront se greffer des interludes poétiques ou métaphoriques, autant d'échappatoires fantasmatiques du personnage central, autant de disgressions formelles et narratives, autant de fragments, de sensations qui s'entremêlent pour accoucher d'une œuvre atypique, intimement lié à la personnalité de son auteur qui dira 'Pour moi, il s'agit toujours de la recherche de la liberté par un langage, par exemple le cinéma. Le coté formel de mes films ce n'est que la méthode, le moyen, ce n'est pas le but de l'œuvre. Il s'agit d'une méthode pour exprimer ce que j'ai à dire . 'Jetons les livres' part dans plusieurs directions sans toujours trop se soucier de sa cohérence, le brassage hétéroclite convoque toutes une palette de sentiments, frustration et éclats de rage de Kitamura s'essayant sans succès à la boxe, mis au ban d'une équipe de football qui le rejette, déprimant en famille et cherchant un peu d'espoir. Mélancolie de l'enfance lorsqu'il se retrouve avec sa sœur venant d'être violée en groupe, traumas et libération sexuelle lors de son initiation d'homme dans un bordel aux couleurs psychédéliques. Les nombreuses intermèdes font parti intégrante du récit et illustrent les états d'âme du héros : motifs récurent de la scène où Kitamurai à bord d'un fragile avion de papier et de bois échoue à s'élever dans les cieux jusqu'à au jour où 'ça y est, il s'est envolé, il a enfin pu échapper à sa mère', insertions de véritables et surprenantes performances de théâtre de rue pour signifier la rage montante du héros : les acteurs haranguent la foule à se défouler sur un punching-ball suspendu en plein Shinjuku, s' écroulent aux sols, fument de l'herbe devant leur regard apeuré et curieux des badauds.
D'autres intermèdes plus contemplatifs recyclent l'imagerie d'un Japon traditionnel : surcharges fascinées de références bouddhiques (fumées, psaumes, objets religieux,..), opposition et abolition de la frontière ville/campagne (bel escamotage du décor qui d'un bordel laisse place à un champ), curieux pastiche de kaidan-eiga, reconstitution enfantine d'un final de ninkyou-eiga sur une plage balayée par le vent, parodie cruelle et amusée de club de rencontres où d'amorphes salariés vieux avant l'age (la hantise de Sasaki) étalent publiquement le vide de leur vie et de leur perversions sexuelles. Interludes théâtraux volontairement inscrits dans leur environnement direct comme pour mieux signifier leur artificialité. Allusions littéraires où les personnages écrivent littéralement sur les murs et citent en vrac : Marx, Malraux, Moyakoski, Fromm. Insertions de photographies contemporaines de son ami Daido Moriyama … Une surabondance thématique qui si elle n'étouffe le propos d'ensemble pèche par orgueil et naïveté : certains poses artistiques sont trop conscientes de leur effets, les références littéraires et culturelle sont pure citations (les jours de football discutent du Capital sous la douche…). Des métaphores quelques fois un peu facile aussi (un lézard prisonnier d'une bouteille de coca-cola comme pour signifier l'étouffement des japonais face à l'ogre américain). Un bouillonnement typique de la veine culture de l'esprit psychédélique de l'époque. L'ensemble séduisant patine quelque peu dans sa seconde partie, la structure narrative sans véritable propos, fatiguante par son accumulation forcée sans véritable liant thématique,.des baisses de tensions et poses artistiques affirmées , le patchwork pas toujours digeste
La musique tient aussi un rôle fondamental, plus qu'une bande-son, elle tient lieu de monologues et de songes, moyen de déréaliser le monde et de transcender le récit en tissant des liens invisibles entres protagonistes inconscients d'une même sensibilité . De remarquables compostions de J.A Caesar, artiste avant-gardiste de référence membre actif du Tenjo Sajiki, qui entretiennent la belle énergie de l'ensemble : Hymnes libertaires et protestataires, révolte contre la figure parentale, comptines subversives ('Quand je serais grande et pute et laisserais la porte grande ouverte pour laisser venir les oiseaux de l'océan), chants plaintifs et nostalgiques à la gloire passée de Takakura Ken (icône du male romantique et viril par excellence).
La réalisation en phase avec son sujet recourt à un style quasi-documentaire hérité de son ami Susumu Hani (Bads Boys, First Love Inferno,..). Démystifiant le médium cinématographique, Terayama ne se soucie d'une certaine crédibilité propre à son univers. Son monde c'est celui de la rue, des ruelles et arrières cours, des maisons crades et exiguës qu'il filme, parfois maladroitement, d'une caméra portée à l'épaule pour mieux retransmettre l'énergie de la vie. Lumière constamment fluctuante, souvent sur/sous exposée. Usage massifs des filtres aux couleurs vives (rose, vert,..), abondance des fumées. Une technique de 'l'image voilée' comme la nomme son réalisateur, comme pour mieux déréaliser son univers et entretenir une confusion entre réel et fiction. L'ensemble filmé avec trois bout de ficelles et un budget ridicule respire l'esprit de débrouillardise et de franche camaraderie (toute sa troupe du Tenjo Sajiki est ici présente), souvent sérieux mais non sans distanciation ironique. Terayama semble peu préoccupé par sa maîtrise de l'appareil, ses films suivants marqueront d'ailleurs une évolution notable de direction artistique avec notamment l'arrivée du célèbre chef opérateur Tatsuo Suzuki
La scène de clôture conclut le film de manière surprenante en donnant un regard rétrospectif sur l'histoire contée : Kitamura arreté par les policers, Kitamura qui se débat et hurle à qui veut l'entendre, puis brusque fondu au noir qui dévoile sur une pièce de théâtre l'ensemble de la distribution du film avec en porte parole Sasaki Hideaki (l'acteur du role de Kitamura Eimei) qui ordonne l'ouverture des lumières et prend la parole sur expérience de tournage. 'Quand la lumière, c'est tout le monde du cinéma qui s'évapore''. Il se remémore les instants passés avec ses amis comédiens et artistes, sa confusion entre son rôle et sa personne ('je parle des mots qui ne sont pas les miens'), parle de sa déprime anonyme le soir rentré dans sa minuscule chambre, remercie Terayama et ses assistants pour cette expérience. 'Essayez donc de projeter un fil en plein jour sur la façade d'un immeuble…, j'ai aimé ce tournage et ces hommes mais n'aime pas ce film, au revoir je ne reviendrai plus, au revoir cinéma' Une scène finale très théâtrale et iconoclaste qui fait écho à celle d'ouverture, assumant ainsi les partis pris singulier du réalisateur, agitateur devant l'éternel qui érigea la provocation comme méthode
Jetons les livres… reste le film le plus célèbre de son auteur dans l'archipel. Comme le dit Terayama le dit, peut importe le moyen seul compte le but. Indéniablement maladroit et naïf, la sincérité et la générosité qu'il dégage font tout son prix. Une démarche artistique stimulante, en phase directe avec l'énergie bouillante de la rue et de sa fièvre artistique et non-conformiste, qui cherche à affirmer les êtres dans leur vérité charnelle bousculant ainsi le monde figé et traditionaliste du cinéma classique. Une nouvelle proposition de cinéma qu'on est en droit de refuser mais qu'il serait dommage d'ignorer. Suite à ce tournage, Terayama se lança a plein temps dans le théâtre de rue (shikai geki) en cherchant toujours encore plus à abolir les frontières de l'espace scénique. En 1974, Cache-cache pastoral, son film suivant, dévoilera un cinéaste assagi, plus contemplatif mais tout aussi torturé. Une singulière fable psychanalytique où fantasmes freudien et introspection marquèrent durablement les esprits.
Retrouvez cette critique illustrée et bien d'autres encores sur
Eiga Go Go!
Quoi, déjà trente-deux ans ?
Disons trente et un pour la sortie en France. Eh bien, tout ce dont je me souviens, c'est que ça n'avait pas grand intérêt. Je n'irai pas le revoir pour vérifier, mais je me demande bien à quelle occasion on pourrait ressortir ce rossignol.